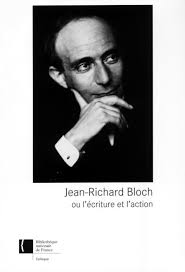
par Tivadar Gorilovics
Étude d’une pièce inédite de Jean-Richard Bloch, par Tivadar Gorilovics.
Horace ou le Cuistre mystifié
Une « étude théâtrale » de Jean-Richard Bloch
I - Les textes
Le manuscrit autographe d’Horace ou le Cuistre mystifié est conservé sous ce titre au Département des Manuscrits de la BnF et consultable maintenant sur microfilm . La pièce, restée inédite, et dont Jean-Richard Bloch a qualifié la seconde version, intitulée Le Cuistre mystifié, de « Conte dramatique en quatre actes » (f.151-304), a une première version, sous le titre d’Horace, en trois actes (ff.4-139), restée, comme du reste la seconde, inachevée en 1910. Sur la page de titre de la première version, on trouve cette précision, signée J. Richard-Bloch [sic] : « Commencée en 1902. Reprise en 1909, puis le 3 janvier 1910. Achevée. » . Nous savons que la seconde version, chargée d’ajouts et de ratures, avait été mise au net et envoyée, le 30 décembre 1912, avec le texte d’une autre pièce, Le Mouton enragé, à Jacques Copeau, accompagnée d’une lettre , où l’auteur de L’Inquiète, fort de son expérience de la scène, acquise à l’Odéon d’Antoine en janvier 1911, mais aussi de tout l’acquis de ses essais critiques publiés dans L’Effort, s’expliquait sur les raisons qui l’avaient amené à « remuer ces poussières », à réunir, en vue de leur publication en volume, ces « études théâtrales » dont il ne se dissimulait, disait-il, « ni les jeunesses ni les faiblesses » . Il se justifiait en ces termes :
De les faire paraître aurait, me semble-t-il, l’avantage de liquider mon passé, sans fausse honte et sans gloriole, en même temps que d’introduire l’avenir et de m’éviter de longues explications ultérieures. Car je crois que le germe de bien des réformes et de bien des formes que j’entrevois se trouve dans ces trois pièces.
S’il s’adresse à Copeau, c’est bien entendu pour demander à l’homme de théâtre qu’il est, « un avis désintéressé et éclairé sur leur valeur et sur l’opportunité d’un pareil geste ». On peut se demander cependant s’il a choisi le meilleur procédé pour obtenir l’avis qu’il sollicite : Copeau a reçu en effet un manuscrit du Cuistre mystifié « où manque la fin de la dernière scène pas du tout au point ». La lettre restera sans réponse, le texte mis au net n’a pas été retrouvé. Ce qui est certain, c’est que « la fin de la dernière scène » se transformera en « épilogue » et comportera finalement deux scènes, mais ce travail complémentaire se fera bien plus tard, en avril 1922 . Il n’est pas interdit de penser que la difficile gestation du Dernier empereur n’était pas étrangère à cette remise sur le métier d’une œuvre dont les quatre actes étaient rédigés. Cette deuxième version ainsi complétée n’en restait pas moins, sauf erreur de ma part, versée aux manuscrits tenus pour ainsi dire en réserve. Ce n’est que cinq ans plus tard qu’un nouveau projet de publication semble se réactualiser : en 1927, l’auteur fait dactylographier son œuvre intitulée cette fois Un début en amour . La pièce est qualifiée de Mystère en cinq temps . On y trouve un Avertissement au lecteur, une analyse des premières sections du « Chapitre premier », enfin une Table dont il ressort que le manuscrit dactylographié devait comprendre 212 pages. Or, et c’est là qu’une autre surprise nous attend : de ces 212 pages, dont seule la page 173 (un fragment de dialogue) est conservée, ne fait pas partie le texte également dactylographié qui correspond à la première scène de l’Epilogue de 1922 et dont la pagination va de 209 à 223 : ces feuillets sont barrés au crayon bleu. Ce qui revient à dire que Jean-Richard Bloch a décidé à ce moment-là de supprimer purement et simplement cette clôture pour ne conserver que la version envoyée à Jacques Copeau. (En quoi il n’avait pas tort, je pense, c’est du moins la conclusion que j’ai tirée de la lecture de l’Epilogue.)
II - Analyse de la pièce
Acte I
(La littérature)
Scène I.
L’action se passe dans la ville de Tours, au XVIe siècle. Trois écoliers, élèves de Maître Benedictus qui « rend la bonne ville de Tours très illustre par son enseignement », causent devant la maison de Maître Jérôme, fraîchement élu premier échevin et maire de la ville. Jean, Horace et Octave représentent trois types différents, chacun tenant le langage qui répond à son caractère.
A la différence de Jean, qui tient des propos irrespectueux sur le compte de Benedictus, Horace, en apprenti cuistre, lui est entièrement dévoué. Octave, c’est la médiocrité même, mais une médiocrité envieuse et sournoise : il tiendra le rôle de l’intrigant, prêt à toutes les bassesses.
Ils voient arriver Georgine, enfant unique de Jérôme, accompagnée de Jeanne, sa nourrice, qui lui explique que ces jeunes gens sont « tous riches, savants et de bonne naissance ».
Devant Benedictus, invité par Jérôme « avec le meilleur de ses élèves », Horace ne peut s’empêcher de dénoncer son camarade Jean, « le meilleur enfant de la Touraine et le plus détestable paresseux de la ville », ce qui provoque ce verdict : « Je te défends de fréquenter ce mauvais garçon ! Il est indocile et rétif, et je ne suis pas encore parvenu à le plier à ma volonté. »
Scène II.
Dans la chambre de Georgine, Jeanne lui explique qu’elle sera bientôt en âge de se marier, mais le mariage : « C’est affaire aux pères et aux vieilles nourrices. » Georgine avoue qu’elle n’a « pour raisonner là-dessus que des idées d’enfant ». Pour elle, le mariage doit être « quelque chose de saint, de nécessaire, de particulier ».
Scène III.
Devant la maison de Jérôme, Horace s’inquiète surtout de se montrer « nigaud » devant la fille de Jérôme. « J’ignore tout de la femme, sinon que c’est une bête perverse et dangereuse, dont les auteurs avertissent de se méfier [...] ». Benedictus comprend tout autrement le rapport de l’homme à l’autre sexe : « La femme, explique-t-il, est une oie qui est trop heureuse d’entendre les caquetages du jars », et il ajoute sans se gêner le moins du monde devant son disciple : « ne méprise pas les hasards qui peuvent occuper une ou deux nuits ».
Scène IV Chez Jérôme, tout fier de sa promotion, l’obséquieux Benedictus se répand en compliments, tandis que les jeunes engagent un dialogue qui montre une Georgine toute simple de manières et pleine de bon sens face à un Horace qui étale sa culture de bon élève qu’il entend mettre, selon les instructions du Maître, au service de son entreprise de séduction. La femme, explique-t-il en conclusion, « n’entre dans notre existence que pour exercer des ravages ou nous rendre les plus heureux des hommes [...] ».
Maître Jérôme, tout à son euphorie d’homme arrivé, prévoit maintenant pour sa fille un mariage à la hauteur de sa nouvelle dignité. « La fille de Maître Jérôme est belle, dit-il, et n’est pas pour le premier venu. » Déclaration dont l’élève de Benedictus saisit parfaitement l’intentionnalité. Le repas commence cependant, on mange, on boit, on plaisante, sauf Horace qui, taquiné par Jérôme, devient de plus en plus sombre. A la demande de Georgine, il n’en récite pas moins un poème qu’il a fait à la manière de Catulle.
Acte II
(La Vanité)
Scène I.
Chez Benedictus, Jean questionne Horace sur le dîner de la veille dont les détails lui font pousser des cris d’admiration. Horace se vante d’avoir conquis la fille de Jérôme : « Je lui exprimai ce qu’étaient les femmes pour nous et cela la rendit tout à coup soumise comme un agneau. On en fait ce qu’on veut. A table elle n’avait plus d’yeux que pour moi [...] » A l’arrivée du Maître, une altercation s’élève entre lui et Jean, surpris en flagrant délit de désobéissance, puisqu’il a causé et mangé. Le conflit dégénère en punition corporelle lorsque Jean, qui réclame son argent, en vient à accuser Benedictus de le voler. Celui-ci, furieux, le met à la porte. Horace est profondément bouleversé par la violence de cette scène, tandis qu’Octave ne trouve rien à y redire. Le rusé Benedictus, pour rassurer Horace, prétend regretter de s’être emporté, et se dit prêt à montrer à son élève les registres de ses comptes. Puis, il le taquine au sujet de Georgine, tout en encourageant Octave à rivaliser avec lui. Horace, piqué au vif, relève le défi et s’en va voir la jeune fille, un exemplaire de l’Imitation de Jésus-Christ sous le bras qu’il est chargé de lui remettre de la part du Maître. Benedictus et sa sœur et complice Catherine s’entendent pour dérober l’argent des écoliers. Leur dialogue ne laisse pas le moindre doute sur leur avilissement.
Scène II.
Horace retrouve Jean sous la pluie, dans la rue. Il lui fait part de ce qui s’est passé. Jean le taquine, mais sans méchanceté. Horace s’énerve... Il reconnaît d’avoir exagéré son succès auprès de Georgine. Mais il raconte aussi qu’on l’a mis au défi de se faire aimer d’elle, défi qui le fait se rebiffer contre Benedictus. Jean cependant reconnaît et met en fuite Octave, dissimulé sous la capuche de Benedictus. Il invite son camarade « chez la veuve Moreau, à l’enseigne des Trois Dames de Cœur ».
Scène III Un nouveau personnage fait son apparition chez Georgine, le Pèlerin, un grand pécheur repenti et assagi qui revient de Compostelle. Il tient un langage qui témoigne de sa capacité à comprendre la jeunesse et ses états d’âme. La nourrice qui pense que le pèlerin ne peut être qu’un « duc ou un prince déguisé », tant il parle bien, raconte combien Georgine, qui l’écoute au bord des larmes, a changé depuis la visite d’Horace. Le pèlerin conclut, un tantinet sentencieux : « Dieu a fait les belles créatures pour qu’elles s’aiment les unes les autres. [...] Les amours qui s’ignorent sont ceux que Dieu bénit. »
Horace arrive, « le visage radieux » qu’assombrit cependant l’inquiétude. Resté seul avec Georgine, il finit par abandonner ses grands airs devant elle, qui cherche à calmer ses inquiétudes. L’intimité du moment les pousse d’abord à des aveux mutuels, puis, brusquement, le versatile Horace recule devant l’engagement définitif et s’enfuit. Georgine demande à la nourrice de courir après lui pour lui dire qu’elle l’a « bien compris, qu’il ne faut pas qu’il prenne peur, qu’il parle seulement à [son] père, qu’il revienne ». Sinon, elle va mourir ou prendre le voile.
Le Pèlerin revient pour demander sa bénédiction à Georgine, cette « âme charitable, droite et aimante », en échange de quoi il se charge de remettre son message à Horace : « Dites-lui que je l’aime et qu’il revienne. » Le Pèlerin sort en disant Amen !
Acte III.
(La Sensualité)
Scène I.
Une rue où il fait de plus en plus sombre. Monologue d’Horace, ballotté entre des impulsions contradictoires - aimer ou rester « libre » ? - et qui fait une dernière tentative pour échapper à son destin.
Suit un épisode franchement comique avec deux personnages, perdus dans la ville, la douairière de Hauterive, à la recherche de son petit-fils prodigue, et Margot, sa suivante. Après leur passage, on voit surgir « deux ombres tendrement enlacées » : ce sera un dialogue grossier entre un « gros sac à graisse » et une « fille à soldats » appelée Micheline qui n’y va pas par quatre chemins pour invectiver son compagnon du moment qui lui propose d’aller chez elle. Horace finit par reconnaître l’homme, c’est Maître Benedictus.
Scène II.
Dans une salle de cabaret entrent d’abord Benedictus et Micheline, puis Horace et enfin Jean avec « une bande de filles et de bons garçons avinés », dont Piedebœuf sur les traces de sa Micheline. Les « bonnes filles », ces habituées du lieu, entourent Horace, l’une d’entre elles l’invitant sans façon : « Êtes-vous libre cette nuit, joli chevalier ? » Horace, sur le point de céder à la tentation de la chair, se sauve finalement pour aller rejoindre Georgine.
Scène III.
La Rue, devant la maison de Jérôme. Georgine guette le retour du pèlerin à la porte d’entrée. Jeanne, torturée de remords, accoudée à la fenêtre, ne parvient pas à la faire remonter dans sa chambre, tandis que Jérôme fait sa prière en pleurant devant le portrait de sa femme. Le pèlerin revient avec Horace qui, voyant Georgine se précipiter tout éperdue au-devant de lui, est « pénétré d’un affreux remords à la vue de cette passion ». C’est sa déclaration d’amour, tant attendue par Georgine, « terriblement angoissée », qui termine le troisième acte.
Acte IV
(L’Amour)
Scène I.
On est dans la chambre de Georgine. Horace, qui « tremble de bonheur et d’ignorance », se dit maintenant un homme, et c’est elle qui a fait de lui un homme. La scène est d’un pathétique qui frise le mélodrame. Le jeune homme avoue qu’il n’a jamais connu d’autres femmes que celles qui sont dans la poésie : « Je prenais les lettres pour la vie. Savais-je qu’il y avait une vie ? » Ne voulant rien cacher devant sa bien-aimée qui l’appelle maintenant son Seigneur, il se met à confesser ses torts : son attachement exclusif au latin, son orgueil de cuistre et, surtout, l’histoire du pari qu’il avait fait de se faire aimer d’elle. L’aveu n’ébranle pas l’amour de la jeune fille. « Je n’ai que ce que je suis à vous offrir, dit-elle, mais je vous le donne, faites-en ce qu’il vous semblera bon. Moi je ne suis que pour vous aimer en vous priant d’être heureux avec moi ! »
Entre-temps survient Benedictus avec Octave qui lui fait part de la présence d’Horace dans la chambre de Georgine. Par pure méchanceté, ils se mettent à lancer des cailloux pour réveiller Jérôme. Horace décide de rester. Jean, qui arrive à la tête d’une mascarade, fait fuir Benedictus. A l’issue d’un imbroglio qui aboutit à une violente confrontation entre Horace et Jerôme, celui-ci lève son épieu sur le jeune homme. Pour Georgine, Horace est désormais son « maître », ce que son père comprend comme un aveu qu’elle a couché avec lui. Horace, parti en courant, promet à Georgine, qui s’évanouit, de revenir.
Scène II La rue devant la maison de Jérôme. La scène est d’abord vide. De vagues rumeurs se font entendre par rafales au loin. Retour d’Octave offrant ses services à Jérôme qui, n’éprouvant que du mépris pour les espions, lui donne, avant de rentrer dans sa chambre, un grand coup de son épieu. Georgine, à sa fenêtre, annonce à Horace qui revient, que son père l’a condamnée « au couvent pour la vie ». Le dénouement approche. Georgine est prête à suivre son amoureux : « Je n’ai plus ni père ni maison. » Elle saute par la fenêtre et ils se cachent « dans l’ombre de la maison ». Pour faire peur à Octave qui n’arrête pas de l’accuser, Jérôme lance un pot de fleurs dans le vide. Georgine s’effondre sur place et ne remue plus. On entend de nouveau le bruit de la cavalcade qui débouche sur la scène avec à sa tête Jean et Guillaumette - puis Piedebœuf, ivre, roulant aux côtés de Micheline.
JEAN (penché sur Georgine). - Apportez les torches, compagnons.
JEANNE. - Non, point de lumières. Vous voulez donc publier notre honte ?
OCTAVE. - A l’aide, c’est Jérôme qui m’a tué, c’est Jérôme l’assassin !
(Les torches se rassemblent autour de Georgine. Jeanne pousse un cri perçant. Jean, qui s’était penché sur la jeune fille, se relève.)
JEAN. - Horace, qu’avons-nous donc fait ?
Rideau
Épilogue
(La Mort)
Scène I.
Une rue. Entrent Madame, suivie de Margot. C’est une longue scène, hautement comique, où ce couple de personnages rencontre aussi Piedebœuf et le patron du cabaret. On apprend par ces derniers ce qui s’est passé au cabaret, puis dans la maison incendiée de Benedictus, en fuite, sa sœur ayant été jetée en prison.
Scène II.
La chambre de Georgine. Le lit de Georgine occupe le milieu de la scène. Georgine, morte, a « la tête tournée vers les spectateurs ». Quatre personnages l’entourent aux quatre coins : Jérôme, la nourrice, le pèlerin et Horace. Aux pieds du lit : Jean. Chacun d’eux s’accuse d’être responsable de sa mort, alors qu’en dernier ressort, ils ont été, avec d’autres acteurs de ce drame, en particulier Benedictus, les instruments d’un destin dont Georgine est la seule victime innocente, Horace, le cuistre mystifié, le plus grand perdant.
III
Ce résumé gagnerait à être illustré par quelques extraits en vue de mieux faire ressortir la tonalité générale et le style propre de ce « conte dramatique » dont son jeune auteur devait préciser :
J’avais quinze ans quand j’ai écrit les premières pages de ce drame. [...] La sincérité est le fruit de l’âge. L’adolescence est menteuse par nature. La jeunesse imite. Elle se joue la comédie de ses héros préférés. Le garçon de quinze ans a été porté spontanément à imiter. Il a repris, tels quels, les personnages traditionnels de la farce classique : le jeune premier, l’ingénue, la nourrice, le père noble, le docteur ridicule, le traître, la duègne, le matamore, le mauvais sujet et la soubrette. Le ton du dialogue est emprunté, sans aucun effort de dissimulation, aux auteurs qui se partageaient mes premières prédilections. Le lecteur saluera tout à tour, au passage, des sonorités de Shakespeare, de Molière, de Musset et de Wagner.
On ne s’étonnera pas que je n’aie jamais reconnu mon véritable visage mieux que dans ce pouding de littérature.
Le décor, en principe historique, Jean-Richard Bloch l’a justifié en ces termes :
Le choix de la période où se déroule l’action procède d’un parti pris : en s’exilant au XVIe siècle pour y suivre le développement d’un drame d’amour, l’auteur a obéi au désir de se dégager, d’une façon aussi complète que possible, des conventions qui régissent, à chaque époque, le vocabulaire de la passion.
Mais cette fiction est en même temps alimentée, nous venons de le voir, par un besoin de projection de soi, en l’occurrence par le truchement d’un dédoublement de la personnalité qui donne dans la pièce le couple antithétique Horace/Jean. Dans une lettre à Marcel Cohen, le 18 juin 1909, c’est-à-dire à un moment où il vient seulement de reprendre « timidement » sa pièce, il oppose à Georgine, la gosse aux yeux clairs et directs, gaie et admirative, le cuistre semblable à l’enfant que j’étais, il y a neuf ans, raide, guindé, appâté par la lumière de la femme et écarté d’elle par sa morgue intellectuelle.
Mais cette pièce est aussi un règlement de comptes avec l’institution scolaire, avec l’enseignement dispensé dans « les lycées de la République » que Bloch explique en ces termes dans un texte ultérieur :
Cet ouvrage est né de la haine et du désespoir.
Ne souriez pas de ces termes véhéments. J’avais quinze ans quand je l’ai conçu et commencé. J’étais élève de rhétorique et, depuis la dixième, dans les lycées de la République. Ce conte a été ma revanche et ma libération. Il m’a aidé à tenir et à vivre. Il me purgeait d’un enseignement hostile à tous les besoins du corps et de l’esprit. Il donnait forme à mes souffrances.
Encore une fois je sens le besoin d’excuser la vivacité des mots que j’emploie, effets d’une adolescence qui, sinon se prolonge, du moins se répercute et se réveille au moindre choc. L’enfance est l’âge des passions fortes. Il tient plus de douleur dans un complet marin pour garçonnet que dans un veston d’homme. Je ne suis pas le seul à avoir éprouvé la suffocation intellectuelle de cet âge à en mourir.
Nos successeurs ne peuvent imaginer l’étouffement que réalisaient les vieux programmes classiques. Discours, dissertations, dialectique, faux-semblant, cartes truquées, des mots, des mots, des mots. Une interminable ratiocination abstraite autour de quelques truismes moraux, pauvres de vérité, vides d’humanité. La poursuite somnolente d’une pureté de forme exsangue, la vénération alanguie d’un idéal conventionnel d’ordre, de clarté, de bon ton, d’harmonie, d’élégance qui ne sentait même plus le musée, mais l’odeur froide et fade du magasin de moulages, cette sacristie de l’art.
Nul contact avec le réel, la nature, le travail, la vie.
Une lettre à Jenny de Vasson, en date du 3 janvier 1910, c’est-à-dire au moment même de la reprise du travail, ne disait pas autre chose :
Je me suis remis à Horace avec un bon enthousiasme d’ouvrier méthodique et maître de son temps, aujourd’hui. Le début, après révision, se tient bien. Mademoiselle, c’est effrayant ce que j’ai perdu en fraîcheur d’invention et en sensibilité spontanée depuis 1902, dont datent les deux premières scènes ! Je n’y aurais pas été capable de mettre sur pied une œuvre viable ; mais j’éprouve le besoin de retrouver par moments des bribes du moi de ce temps-là pour m’aider à secouer de dessus mes épaules le poids de l’école.
Mais le cuistre Horace, on l’a vu, se convertit en un amoureux sincère et passionné, « mystifié » par le dieu Amour qui lui apparaît sous les traits de « la gosse aux yeux clairs et directs, gaie et admirative ». Et là, nous avons affaire comme à un duo d’opéra romantique ; là, c’est le souvenir du coup de foudre de 1905 pour Marguerite Herzog et le brûlant discours amoureux qui en est sorti dans sa correspondance avec elle, qui semble inspirer le jeune auteur.
IV Le théâtre, une vocation précoce
Jean Albertini a souligné à juste titre que « l’auteur de Destin du théâtre a entretenu, dès son adolescence, une familiarité constante » avec le théâtre, « aussi bien dans le domaine de la création que dans celui de la réflexion. A quatorze ans, c’est à l’occasion d’une entreprise de théâtre amateur, la mise en scène des Plaideurs, qu’il se lie avec Marcel Cohen. Dès qu’il commencera d’écrire, il mènera de front des œuvres romanesques et théâtrales . » Michel Autrand, de son côté, caractérisait Jean-Richard Bloch comme « un homme pour qui le théâtre est une des formes de l’essentiel ».
Parmi les diverses réflexions, consignées au mois de mai 1900 sur des feuilles volantes et destinées à son ami Marcel Cohen, on lit en particulier ceci :
Il ferait une grande œuvre l’homme qui aurait assez de temps et de talent pour élever l’édifice que j’entrevois.
D’abord, par une suite d’ouvrages, romans, pièces, etc., montrer l’homme bas . [...]
Mon aspiration fondamentale, c’est la littérature personnelle, le théâtre. Quelque chose me l’interdirait tout à coup, je serais comme un vaisseau perdu en mer, sans pilote, sans boussole, sans gouvernail et sans voiles. [...]
Être Ibsen ou rien. :
Le 26 octobre 1905, il « avouera » à sa fiancée :
J’ai besoin de te dire encore autre chose : j’ai longtemps écrit ; ce fut pendant toute ma jeunesse mon idée fixe, une hantise qui ne me lâchait pas ; je voulais faire du théâtre ; maintenant encore je n’ai pas renoncé à ces ambitions qui me paraissent, en dépit de tous mes raisonnements, les plus belles que je puisse concevoir.
L’aventure théâtrale de Jean-Richard Bloch plonge ses racines dans la fascination qu’exerce, de très bonne heure, sur lui le théâtre comme lieu de représentations qui l’émerveille à la fois par son côté spectacles et par ses rites. Mais elle est motivée en même temps par une adolescence difficilement vécue qui semble se prolonger et dont témoigne cette phrase relevée dans une longue dissertation de philosophie de décembre 1901 : « La définition de l’homme pourrait être celle-ci : un animal inquiet . Inquiet de soi surtout, et par contrecoup, de ce qui l’entoure . »
Appendice
Jerôme. - Hélas, mon seigneur Dieu, prenez ma vie, prenez mon honneur, prenez mon salut. J’ai tué. J’ai frappé devant moi, dans la nuit comme une bête sauvage, et le coup que je dirigeais sur autrui s’est retourné contre ma maison. J’ai tué. Et j’ai tué mon amour, j’ai tué la fleur et la mélodie de mes jours, j’ai tué ma précieuse colombe blanche, j’ai tué Georgine, j’ai tué ma petite fille.
La nourrice. - Taisez-vous, Maître Jérôme. je ne peux pas supporter le son de votre voix, et vous n’avez pas le droit de dire des phrases pareilles. Il n’y a de coupable ici que moi. C’est moi qui avais la charge ici de la mère, qui ai mésusé de ma charge. Je suis la mauvaise intendante du bien qui m’avait été commis, je suis la mauvaise ménagère de l’existence qui m’avait été remise ; j’ai vu le péché naître, et j’ai ri au péché ; j’ai vu le malheur se lever et j’ai fait signe au malheur ; j’ai vu la mort approcher et je n’ai pas reconnu la mort. S’il m’étais permis d’appeler encore votre regard compatissant sur la honteuse pécheresse que je suis, Très Sainte Mère de Dieu, puisque je ne dois plus retrouver ma petite adorée dans votre paradis, puisque je l’ai séparée de moi pour toujours, faites que les flammes de ma damnation ne m’attendent pas trop longtemps. C’est moi, Jérôme, c’est moi qui ai tué notre Georgine, c’est moi qui ai tué votre petite fille.
Le Pèlerin. - C’est moi qui ai tué votre petite fille, Jérôme, et nulle autre personne que moi. Honte sur la fausse expérience que nous donne une vie passée dans le goût du monde, honte sur l’orgueil que nous inspire un pélerinage aux lieux saints, honte sur la sécurité dont nous emplissent la confession de nos péchés et notre dessein d’expier. De vous tous, moi seul étais à même de nommer l’infortune qui se préparait ; je l’ai nommée, mais le siècle me tenait si fort et la confiance en moi, que j’ai pris pour une inspiration secrète ce qui n’était que pitié mauvaise pour un joli visage. C’est moi qui, m’étant levé d’entre vous et étant sorti de la maison qui m’avait accueilli, suis allé quérir par la main la mort qui hésitait.
Jerôme. - Taisez-vous, car votre voix m’empêche de vous pardonner.
Horace. - Et la mort, Jérôme, la mort, ce fut moi. Vos fautes à vous trois sont bien légères au prix de la mienne. Vous ne fûtes qu’ignorant de la mort, aveugle à la mort, ou complaisant à la mort. Vous ne fûtes qu’ignorant du péché, aveugle au péché ou serviable au péché. Moi je fus le péché. Georgine vivrait encore si je ne lui avais adressé la parole, si je n’avais pas vécu. J’ai tué votre petite fille, j’ai détruit la fleur, la clarté et le plaisir de votre vie ; mais en sus j’ai tué celle qui se préparait à racheter ma vie, et c’est moi, moi, moi seul qui ai tué Georgine .
Jerôme. - Tais-toi, car ta voix me donne envie de mal faire.
Jean. - Horace ne l’aurait pas fait si je ne l’avais défié par mes railleries. Nous sommes trois qui avons pensé rire un instant, et voici notre maître recherché, sa sœur en prison, leur demeure consumée, mes compagnons dispersés. Tu as prétendu vivre une heure et voici là morte ta douce et jolie bien-aimée, voici Jérôme affligé pour la vie, une pauvre femme perdue, le salut d’un homme compromis, ton ami désespéré, et toi...
Horace. - Et moi retranché du meilleur de moi-même, moi solitaire pour toute la durée d’une longue vie, moi ensemble affligé, perdu, damné, désespéré.
Jean. - Tais-toi, Horace, car tu es celui de nous tous qui as le moins perdu.
Tivadar Gorilovics
